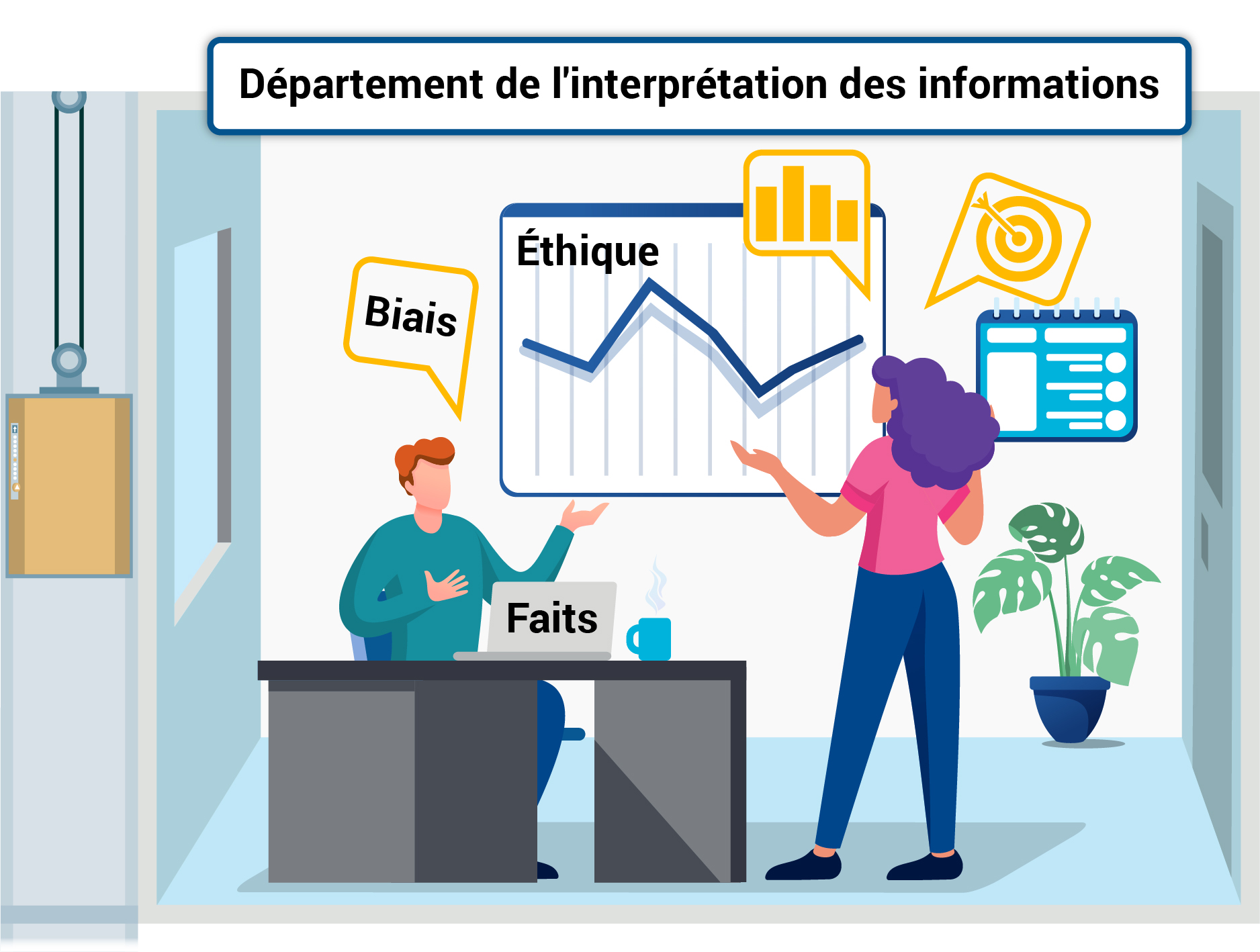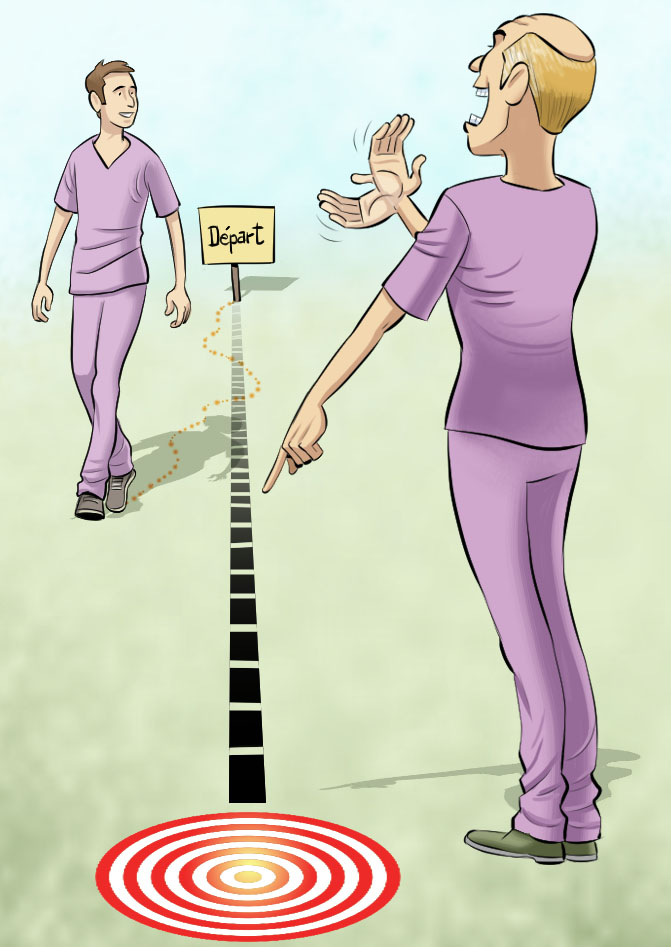Dire plutôt : « ... porte un chandail qui gêne ses mouvements; qui dévoile une partie du corps. » Par exemple, « On voit le nombril de Jean lorsqu’il lève les bras. »
UNITÉ 4
Interpréter les informations recueillies
Orientation à l’unité 4
Dans cette unité, vous serez appelé à réfléchir sur les éléments qui permettent de bien interpréter les faits que vous avez recueillis. Nous verrons comment cette étape s’articule pour mener à un jugement sur le rendement de votre stagiaire.
Interprétation
Introduction à l’interprétation des informations recueillies
À l’unité 3, nous avons vu plusieurs moyens de recueillir les faits sur le rendement du stagiaire. L’étape suivante, consiste à les interpréter pour porter un jugement sur les compétences du stagiaire. L’interprétation des informations est étroitement liée à la qualité et à la diversité des informations recueillies à l’étape précédente.
Afin de réaliser une analyse juste des informations observées, le superviseur doit tenir compte de divers éléments dont :
Les étapes à suivre pour porter un jugement
Les biais cognitifs
Les notions d’éthique
Interpréter pour porter un jugement
L’interprétation est la phase qui précède le jugement posé sur le rendement du stagiaire.
info_outline Consignes :
- Cliquez sur les boîtes pour en savoir plus.
- Cliquez sur le bouton « Fermer » ou le X pour refermer la fenêtre.
Interprétation
Faits
Jugement
Téléchargez la version imprimable : Interpréter pour porter un jugement (.pdf, 326 Ko).
Bien que ces notions soient bien comprises, c’est au moment d’interpréter les informations que se présente le défi!
assignment Activité : Observation ou jugement sans fondement?
info_outline Consignes :
- Pour chacun des énoncés suivants, précisez s’il s’agit d’une observation ou d’un jugement sans fondement.
- Corrigez les énoncés formulés comme un jugement sans fondement, de sorte qu’ils soient observables.
- Lisez la rétroaction au fur et à mesure pour chacun des énoncés qui sont un jugement afin de les comparer à nos réponses.
Note : Vos réponses ne sont pas sauvegardées.
Comme vous venez sans doute de le constater par cette activité, il n’est pas si facile de toujours formuler nos observations sous forme de faits concrets.
Lorsqu’on reformule un énoncé en y précisant les faits vus, lus ou entendus, celui-ci se présente alors comme une observation.
À la lecture des informations recueillies (phase d’interprétation), il importe donc de retenir seulement les observations qui respectent une formulation adéquate afin de porter un jugement le plus objectif possible.
Demeurer objectif : un défi en soi!
L’interprétation des informations liées aux savoirs de votre stagiaire est une étape qui présente également des défis en raison de la multitude des informations à analyser.
Examinons la situation suivante pour mieux comprendre les pièges à éviter à l’étape de l’interprétation des informations.
assignment Activité : La superviseure interprète les informations
info_outline Consignes :
- Visionnez la capsule vidéo suivante en cliquant sur le bouton. Une nouvelle fenêtre s’ouvrira.
- Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de la vidéo.
- Pensez à des éléments de la situation qui influenceront l’interprétation des informations recueillies pour répondre à la question ci-dessous. Votre réponse n’est pas sauvegardée.
- Consultez ensuite la rétroaction.
Dans cette situation, on voit que la superviseure pose un jugement qui ne repose pas sur des faits. De plus, on voit que l’interprétation des observations est influencée par ses caractéristiques personnelles. Mais comment peut-on faire abstraction de celles-ci?
Poser un jugement objectif, c’est possible?

L’objectivité d’une évaluation est une question qui demande une longue réflexion. Comment un superviseur peut-il éviter un jugement trop subjectif? Une objectivité totale est impossible, car vous ne pouvez pas vous départir de vos valeurs et de vos émotions. Néanmoins, le fait d’accepter la présence d’une part de subjectivité dans un jugement professionnel ne le rend pas pour autant invalide.
En effet, la prise de conscience de l’aspect subjectif de votre jugement vous pousse à analyser et à préciser votre jugement lors d’une évaluation afin d’être le plus objectif possible. À cet effet, les stratégies proposées dans les étapes précédentes, soit dans la planification et la collecte de l’information, demeurent toujours la base. Votre jugement sera entre autres plus objectif si vous :
- Évaluez de façon continue
- Consignez les informations pertinentes relatives aux comportements du stagiaire au fur et à mesure qu’ils se produisent, etc.
Comme vous le voyez, porter un jugement sur le rendement du stagiaire requiert une conduite structurée et une réflexion sérieuse. La suite du processus évaluatif en dépend ainsi que les apprentissages du stagiaire. L’interprétation est à la base du jugement et ultimement de la note qui sera accordée au stagiaire. Voyons d’autres éléments qui peuvent influencer le jugement du superviseur en évaluation.
Prendre conscience de ses propres biais cognitifs
Comme on vient de le voir, même quand on a les meilleures intentions du monde, l’interprétation des informations et le jugement qui en découle comportent une part de subjectivité. Certains facteurs peuvent fausser l’évaluation quand une personne en évalue une autre, c’est ce qu’on appelle des « biais cognitifs ». Dans la majorité des cas, l’individu ignore ce qui est en train de se produire. Pourtant, la prise de conscience de ses propres biais cognitifs est la meilleure façon de les contrer.
En outre, il a été démontré que les individus ayant suivi une formation sont plus à même de réduire leurs biais cognitifs.
Ces biais peuvent être catégorisés de diverses façons. Nous vous proposons quatre catégories regroupant les biais cognitifs les plus courants chez les superviseurs lors de l’évaluation des stagiaires.
| Catégorie | Relatif au jugement | Relatif à la mémoire | Relatif aux tendances de l’évaluateur | Relatif aux circonstances |
|---|---|---|---|---|
| Définition | Certaines informations sont mises en valeur au détriment d’autres renseignements, ce qui altère la capacité du superviseur à prendre des décisions. | Les souvenirs marquants ou répétitifs reviennent plus facilement en mémoire alors que d’autres sont éliminés, ce qui influence les choix du superviseur. | Le superviseur a certaines prédispositions personnelles (par rapport à l’évaluation, à la culture, au genre, etc.) qui influencent ses décisions et son comportement. | Le contexte dans lequel se produit une situation influence l’évaluation qu’en fait le superviseur. |
| Biais cognitifs |
|
|
|
|
Références
Vous avez vu dans la section précédente des stratégies générales pour demeurer objectif. Nous vous proposons maintenant la définition de divers biais ainsi que des stratégies spécifiques qui vous aideront à réduire vos biais cognitifs.
info_outline Consigne : cliquez à tour de rôle sur chacun des cercles pour en savoir plus sur les différents biais, y compris les définitions, les exemples et les stratégies.
1. L’effet de halo
Tendance à porter un jugement global sur le rendement à partir d’un ou deux éléments, soit parce que vous les jugez plus significatifs, soit parce qu’ils sont plus perceptibles. Le stagiaire est donc sous-évalué ou surévalué sur un nombre restreint d’éléments ne représentant pas son rendement réel.
Par exemple :
Le rendement général de votre stagiaire est satisfaisant, mais il ne maîtrise pas l’une des interventions. Vous lui donnez alors une note de C.
Pour contrer ce biais :
Consultez toutes vos sources pour revoir l’ensemble des faits observés.
2. L’effet de sévérité et d’indulgence (hawk-dove)
Tendance à manifester trop de sévérité ou de clémence lors de l’évaluation du stagiaire. Contrairement aux autres biais cognitifs, l’effet hawk-dove se produit souvent de manière consciente.
Le superviseur dit « faucon » est beaucoup plus attentif aux erreurs commises par le stagiaire qu’à ses bons coups et a des standards plus élevés que la moyenne. Le stagiaire est donc sous-évalué.
À l’inverse, le superviseur dit « colombe » est trop indulgent envers le stagiaire, car il est réticent à donner une évaluation négative. Le stagiaire est donc surévalué.
Par exemple :
- Vous cotez le rendement de votre stagiaire comme « passable », car il a commis quelques erreurs, même s’il est généralement très bon.
- Votre stagiaire commet plusieurs erreurs, mais il en est à son deuxième stage seulement, alors vous laissez passer sans le mentionner dans son évaluation.
Pour contrer ce biais :
Portez une attention particulière aux forces du stagiaire tout autant qu’à ses défis afin de prendre position.
3. L’erreur de la tendance centrale
Tendance à maintenir l’évaluation du stagiaire dans la moyenne même lorsque le niveau de rendement varie, soit pour satisfaire tout le monde ou parce que vous manquez d’expérience en évaluation.
Par exemple :
Vous donnez une note de 7,5 sur 10 pour les différents critères à évaluer. De cette façon, votre stagiaire ne posera pas trop de questions.
Pour contrer ce biais :
- Utilisez des échelles nominales à choix, sans cote centrale (p. ex. très satisfaisant, satisfaisant, insatisfaisant, très insatisfaisant)
- Utilisez des échelles descriptives listant les comportements attendus
4. L’effet d’ancrage
Tendance à évaluer le stagiaire selon l’information initiale (la première impression) dont vous disposez. Vous retenez alors l’information susceptible de confirmer votre jugement initial et ignorez les renseignements qui entrent en contradiction avec ce premier jugement.
Par exemple :
Votre stagiaire ne respectait pas le code vestimentaire lors de sa première journée. Vous lui avez donc donné une mauvaise note quant au respect des normes de travail de l’établissement.
Pour contrer ce biais :
Introduisez d’autres sources d’évaluation, telles l’autoévaluation et l’évaluation 360°.
5. L’effet de récence
Tendance à évaluer le stagiaire selon l’information la plus récente dont vous disposez. Un événement récent, qu’il soit positif ou négatif, prend alors une place disproportionnée dans votre esprit, camouflant ainsi les faits antérieurs à cet événement.
Par exemple :
Votre stagiaire est habituellement apte à remplir ses dossiers. Cependant, celui qu’il vous a remis cette semaine n’était vraiment pas complet. Vous donnez alors une note de C pour la documentation clinique.
Pour contrer ce biais :
Retournez dans vos notes pour relire tous les faits et vous les remémorer.
6. L’effet de contraste
Tendance à évaluer le stagiaire par comparaison avec un modèle type (avec un autre stagiaire vu précédemment ou avec vous-même) plutôt que par rapport aux critères établis.
Vous évaluez donc le rendement en fonction de l’écart entre ce que le stagiaire a produit et ce que le modèle type aurait fait.
Par exemple :
- Vous notez le rendement du stagiaire comme passable, car il n’a pas les compétences que vous aviez lorsque vous étiez vous-même stagiaire.
- Lorsqu’un stagiaire fort suit un stagiaire plus faible, il est possible que le fort soit perçu comme encore plus fort. L’inverse est aussi vrai.
Pour contrer ce biais :
Évitez de comparer le rendement des stagiaires entre eux ou avec votre propre façon de faire.
7. L’effet de contamination
Tendance à se laisser influencer par les évaluations passées du stagiaire (bonnes ou mauvaises) lors de l’évaluation en cours. Vous pouvez, par exemple, en avoir entendu parler par un autre collègue l’ayant eu sous sa supervision.
Par exemple :
Votre stagiaire, Éric, était sous la supervision de votre collègue Antoine lors de son stage précédent. Antoine vous a mentionné qu’Éric avait à l’époque de la difficulté à faire des prises de sang. Lors de l’évaluation du stagiaire, vous notez donc cette intervention comme « à améliorer ».
Pour contrer ce biais :
Mettez-vous des « œillères » quand vous entendez parler du rendement de votre stagiaire dans des stages antérieurs.
8. L’effet miroir (ou erreur de similitude avec l’évaluateur)
Tendance à surestimer le rendement des stagiaires ayant certaines affinités avec vous (partage de valeurs, intérêts ou traits de personnalité semblables).
Par exemple :
Votre stagiaire est gêné avec les patients et cela nuit à sa manière de communiquer. Étant vous-même de nature timide, vous comprenez qu’il fait de son mieux et lui donnez une bonne note en communication.
Pour contrer ce biais :
Introduisez d’autres sources d’évaluation, telles l’autoévaluation et l’évaluation 360°.
9. Le biais interculturel
Tendance à appliquer vos attentes culturelles à quelqu’un dont les croyances et les attentes sont fondamentalement différentes.
Les biais interculturels peuvent transparaître dans l’interprétation des mots (lorsque le français n’est pas la langue maternelle du stagiaire), dans l’importance accordée à la réussite et dans la façon d’offrir de la rétroaction au stagiaire (certains groupes culturels s’attendront à ce que le superviseur commence par les points forts, alors que d’autres mettent l’accent sur les défis).
Par exemple :
Votre stagiaire est d’origine asiatique et le français est sa troisième langue. Lors de l’évaluation de son raisonnement clinique, les réponses qu’il vous a données n’étaient pas complètes. Vous lui mettez donc la note « insatisfaisant » pour cette dimension, sans savoir qu’il n’avait simplement pas compris les questions que vous lui aviez posées.
Pour contrer ce biais :
- Suivez une formation sur la diversité culturelle
- Développez une sensibilité culturelle
10. Le biais d’attribution
Tendance à attribuer au stagiaire une mauvaise performance, alors que celle-ci découle en fait du contexte (utilisation d’équipement dépassé, manque de ressources, etc.).
Par exemple :
La majorité de l’équipement disponible dans la clinique où vous travaillez est dépassé. Votre stagiaire n’en maîtrise pas l’utilisation, car il ne l’a jamais vu dans ses cours. Il fait donc plusieurs erreurs lors de ses interventions. Vous notez qu’il n’a pas les compétences requises à son niveau.
Pour contrer ce biais :
- Prenez en compte le contexte de la situation lors de l’évaluation du rendement
- Placez-vous dans la peau du stagiaire
11. Le biais de désirabilité sociale
Tendance à surévaluer le stagiaire afin de vous présenter sous un jour favorable. Vous souhaitez être bien vu et réprimez vos commentaires négatifs pour ne garder que ceux qui plairont au stagiaire.
Contrairement aux autres biais cognitifs, le biais de désirabilité sociale se produit souvent de manière consciente.
Par exemple :
Vous sentez que votre stagiaire est distant avec vous, qu’il ne vous apprécie pas beaucoup. Vous ne voulez pas qu’il se mette à vous détester, vous évitez donc de lui offrir de la rétroaction ou de lui donner de mauvaises notes.
Pour contrer ce biais :
- Déterminez votre degré de désirabilité sociale à l’aide d’une échelle de mesure, telle que la version abrégée du Balanced Inventory of Desirable Responding
- Prenez le temps de vous questionner par rapport à l’influence de votre degré de désirabilité sociale sur votre interprétation
12. L’effet de l’ordre
Tendance à surévaluer ou sous-évaluer les travaux de vos stagiaires en fonction de leur place dans la pile de copies.
Cet effet est présent seulement dans certaines professions lorsque le professionnel supervise un groupe de stagiaire et corrige leurs travaux écrits.
Par exemple :
- Vous corrigez d’abord le travail de Stéphane, qui est de très bonne qualité. Vous corrigez ensuite le travail d’Émilie, qui est nettement inférieur à celui de Stéphane. Vous êtes donc plus sévère dans la correction.
- Vous corrigez d’abord le travail de Marc, qui ne répond pas du tout aux attentes. Vous corrigez ensuite le travail d’Élise, qui est de meilleure qualité et vous semble exceptionnel comparé à celui de Marc. Vous êtes alors plus indulgent dans la correction.
Pour contrer ce biais :
Évitez de comparer les travaux des stagiaires entre eux.
Téléchargez la version imprimable : Prendre conscience de ses propres biais cognitifs (.pdf, 277 Ko).
assignment Activité : De quel biais cognitif s’agit-il?
info_outline Consignes :
- Visionnez les mises en situation suivantes. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de la vidéo.
- Sélectionnez le biais cognitif représenté par celles-ci.
- La rétroaction apparaîtra automatiquement.
Note : Certains biais ne seront pas représentés.
L’éthique en évaluation, c’est plus juste!
L’éthique en évaluation de rendement est un concept peu étudié en éducation. Cependant, cette notion transparaît dans tout le processus de l’évaluation.
En effet, l’éthique entre en jeu dans divers domaines de l’évaluation : le sens de l’échec, l’équité, le plagiat, les enjeux affectifs, le marchandage de la note, le caractère confidentiel ou public d’un résultat académique, la justice, la valeur de l’autoévaluation, l’objectivité, etc..
De plus, l’application des principes éthiques est à la base d’une évaluation juste et de qualité.
En tant que professionnel, nous savons que nous devons faire preuve d’éthique, car un code de conduite (ou code déontologique) oriente nos actions. En supervision, les superviseurs doivent faire preuve d’éthique en tout temps, mais l’évaluation est une activité qui demande de s’appuyer sur des principes éthiques spécifiques, et ce, particulièrement lorsqu’il est temps de porter un jugement. Cependant, plusieurs superviseurs doutent de leur jugement, car ils savent que celui-ci contient une part d’arbitraire.
assignment Activité : Des comportements éthiques ou non?
info_outline Consignes :
- Visionnez la capsule vidéo. Pour fermer, cliquez sur la zone extérieure de la vidéo.
- Répondez ensuite à la question.
- Lisez la rétroaction proposée.
Vous avez sans doute indiqué que Caroline manque de rigueur dans sa façon de procéder, mais aussi à son devoir de confidentialité et de transparence.
Un superviseur ayant peu de connaissances en évaluation peut, sans le vouloir, agir avec un sens de l’éthique moins rigoureux. Toutefois, nous avons déjà vu plusieurs stratégies que vous pouvez utiliser pour faire preuve de rigueur dans le processus évaluatif. Celles-ci pourront vous permettre d’encadrer votre stagiaire d’un point de vue éthique.
Par exemple, nous avons proposé de :
- Planifier le processus évaluatif (unité 2)
- Réviser régulièrement les instruments d’évaluation, les critères, les indicateurs, la fréquence des évaluations et les formules d’évaluation (unité 3)
- Réviser régulièrement les modes et les stratégies d’évaluation, etc. (unité 3)
- Reconnaître une part de subjectivité dans les évaluations (penser aux biais!)

Nous avons toutefois peu discuté de deux autres principes éthiques observés dans la vidéo, mais dont vous devez également tenir compte :
- Respecter la confidentialité
- Faire preuve de transparence

La confidentialité
En quoi consiste le devoir de confidentialité du superviseur à l’étape du jugement?
Cela suppose que le superviseur s’engage à prendre des actions qui feront en sorte qu’il respectera les lignes directrices qui sont normalement rédigées en ce sens par l’établissement.
Dans la vidéo, Caroline parle du rendement de son stagiaire à sa collègue Véronique, qui n’a clairement pas besoin d’être mise au courant de la situation. La discussion se tient aussi dans un lieu public.
Pour faire preuve de confidentialité en évaluation, le superviseur peut notamment :
- Recueillir seulement les informations qui sont pertinentes au stage
- Partager les informations recueillies et le jugement porté sur le stagiaire uniquement avec les personnes qui ont des raisons justifiées de connaître ces renseignements
- Protéger les documents d’évaluation afin qu’ils ne soient pas librement accessibles

La transparence
En quoi consiste le principe de transparence quand vient le temps de porter un jugement?
Si le superviseur fait preuve de transparence, c’est donc dire que le stagiaire sait exactement à quoi s’attendre lors de son évaluation. Il connaît entre autres les outils qui serviront à évaluer ses compétences et les objectifs ou les critères sur lesquels il est évalué.
Dans la vidéo, Caroline ne semble pas avoir pris le temps de bien expliquer au stagiaire le processus d’évaluation et espère même ne pas lui causer de surprise lorsqu’elle lui fera part de son jugement.
Ainsi, le respect du principe de transparence implique que le stagiaire ne se fera pas surprendre par des éléments nouveaux en ce qui concerne son évaluation. Le superviseur lui aura communiqué clairement à l’avance les détails de celle-ci.
À cet effet, le contrat présenté à l’unité 2 est un bon moyen de faire preuve de transparence.
Concepts clés
Pour bien interpréter les informations recueilles et porter un jugement juste, il importe de retenir que :
- Le jugement consiste à émettre une conclusion ou une opinion sur les compétences acquises et qu’il doit reposer sur des faits mesurables.
- Pour demeurer objectif dans son jugement, le superviseur doit accepter la présence d’une part de subjectivité tout en gardant en tête ses filtres personnels, en évitant de sélectionner les faits et de généraliser.
- La prise de conscience de ses propres biais cognitifs est la meilleure façon de les contrer.
- Les notions éthiques de rigueur, de transparence et de confidentialité doivent être mises de l’avant pour porter un jugement objectif.